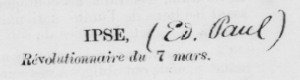La pensée économique d’Edmond Paul
Le professeur d’Edmond Paul, Michel Chevalier, était un homme d’État important et un intellectuel saint-simonien qui écrivait sur l’industrie, la politique monétaire et le commerce ; ses idées influencent clairement Edmond Paul, qui commence à écrire immédiatement après la fin de ses études. Cependant, Paul ne se contente pas de répéter ce que Chevalier lui a appris. Il a lu un large éventail d’auteurs, comme le montrent ses fréquentes citations, et il a su adapter aux particularités du contexte haïtien les idées qu’il avait apprises ailleurs.83 Nous pouvons considérer Edmond Paul comme un penseur original, enraciné dans ce qu’Erik Reinert appelle la tradition de « l’Autre Canon » de l’économie.84
Pour Edmond Paul, le principal problème d’Haïti est que le pays exporte des produits de base en échange de produits manufacturés importés. Il considère que le manque d’industrie est la cause profonde de nombreux autres problèmes, notamment l’instabilité politique, la corruption du gouvernement, le chômage dans les villes, la non-rentabilité du commerce local, l’oppression des paysans, les troubles sociaux, l’inégalité fondée sur la politique coloriste, les représentations racistes d’Haïti par les étrangers et la dépendance à l’égard des puissances étrangères, qui affaiblit la souveraineté nationale.85 La principale solution consistait à faire ce que tous les pays riches avaient fait pour s’enrichir : créer des industries manufacturières dans les villes, par le biais d’une politique industrielle.86
L’industrialisation créerait de la richesse et des opportunités. Avec des usines, le pays aurait moins besoin d’importer des produits qu’il pourrait produire lui-même. On transformerait les produits de base avant de les exporter ; par exemple, le cacao quitterait Haïti sous la forme de chocolat, un produit fini qui se vendrait plus cher que la matière première.87 Avec de bons emplois manufacturiers dans chaque ville et bourg haïtien,88 une population croissante deviendrait un avantage plutôt qu’un problème.89
Une économie urbaine diversifiée créerait des alternatives à la politique comme voie de mobilité sociale, contribuant ainsi à réduire la corruption et l’instabilité. De même, elle réduirait la dépendance à l’égard de la taxe sur le café, principale source de revenus de l’État et de l’élite urbaine, ce qui atténuerait la pression économique exercée sur les producteurs paysans.90 L’industrialisation permettrait également l’épanouissement culturel en créant une source de financement pour l’éducation et les arts.91
L’accent mis par Edmond Paul sur l’industrialisation ne l’a pas conduit à négliger le rôle de l’agriculture.92 En effet, ses propositions concernant l’agriculture étaient si détaillées que, même plusieurs années après sa mort, le gouvernement s’en est servi comme d’un modèle pour renouveler la politique agricole.93 Cependant, il insiste sur le fait qu’Haïti doit modifier son avantage comparatif pour ne plus être « essentiellement agricole », car l’agriculture ne peut véritablement prospérer que si elle est accompagnée de l’industrie.94 De plus, il a plaidé pour une diversification des métiers de production et de service dans les villages ruraux, ce qui était légalement interdit à l’époque.95
Edmond Paul était conscient des risques de l’industrialisation, à laquelle on reprochait souvent d’être source d’inégalités sociales et d’exploitation des pauvres. Selon lui, la misère dans les contextes industriels est le résultat d’injustices, mais elle n’est pas inhérente à l’industrie elle-même ; une fois le pays industrialisé, les travailleurs peuvent se battre pour obtenir de meilleurs salaires.96 Les terres haïtiennes étant déjà bien réparties et aux mains des Haïtiens, il affirme que l’industrialisation ne causerait pas le même type de problèmes en Haïti que dans d’autres pays.97
Il était conscient des défis pratiques à relever pour faire passer la structure de production d’un pays d’une orientation agricole à une orientation industrielle. Il a prôné une série de politiques industrielles, y compris des protections temporaires pour certains secteurs afin de substituer des productions nationales aux produits importés,98 ou encore des subventions pour les industries orientées vers l’exportation.99 Il a appelé à un effort majeur pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences à travers l’envoi de jeunes haïtiens faire leurs études à l’étranger,100 le recrutement d’experts étrangers pour enseigner en Haïti,101 la formation d’enseignants et la création d’écoles dans tout le pays,102 ainsi que la modification du programme scolaire pour mettre l’accent sur les disciplines scientifiques et techniques.103 Il a également plaidé en faveur de l’investissement dans la recherche pour l’innovation.104
Bien sûr, Edmond Paul était conscient que le gouvernement et l’élite urbaine vivaient très confortablement des taxes sur les exportations de café, aux dépens des producteurs paysans, et qu’il serait difficile de leur faire accepter un mode d’organisation de l’économie plus exigeant. Il a tout de même essayé, en présentant des arguments détaillés pour montrer comment le système actuel nuisait à la fois à l’économie et à la société.105 Pour créer un environnement propice à sa vision du développement, il a lutté contre la corruption dans les institutions publiques et a proposé que des fonctionnaires compétents soient chargés de l’administration publique.106
Il convient ici de souligner qu’Edmond Paul n’était pas un « libéral économique » dans le sens de quelqu’un qui soutient le libre-échange et un gouvernement limité comme des principes à privilégier dans tous les contextes. Il considérait que le libre-échange n’était souhaitable que lorsque la structure productive du pays avait atteint sa maturité, c’est-à-dire lorsqu’elle était en mesure de faire face à la concurrence étrangère et de s’engager dans des échanges symétriques.107 Pour y parvenir, le gouvernement doit intervenir, notamment en protégeant les industries naissantes de la concurrence extérieure pendant un certain temps.108 En ce sens, il a souligné que le libre-échange ne devrait pas être appliqué comme un principe absolu, en particulier dans la situation actuelle d’Haïti.109
Certains chercheurs contemporains semblent avoir manqué ce point, peut-être parce qu’ils n’ont eu accès qu’à son livre sur l’élimination des taxes sur le café (et donc pas à ses livres sur la politique industrielle), et à cause de l’ambiguïté du terme « libéral ».110 Pour Edmond Paul, le libéralisme, c’est d’abord l’État de droit, la stabilité des institutions, la technocratie et la méritocratie, combinés à l’éducation publique et à la politique industrielle.111 Selon lui, la véritable liberté – au sens de la dignité personnelle, de l’autonomie économique et de la souveraineté politique – serait le fruit ultime d’un changement structurel dans le secteur productif de l’économie.112
Conscient qu’il fallait trouver des sources de financement pour mettre à niveau la structure productive du pays, Edmond Paul a avancé que les protections données par l’État inciteraient les capitalistes nationaux et étrangers à prendre le risque d’investir dans le pays.113 Les étrangers des pays industrialisés apporteraient non seulement leur argent, mais aussi leur technologie et leur savoir-faire, afin de profiter des avantages accordés aux entreprises basées en Haïti.114 Par ailleurs, il a rédigé un projet de loi proposant que les fonds gouvernementaux provenant de la taxe sur le café soient utilisés pour créer une banque qui fournirait des crédits, avant de supprimer la taxe au bout de quatre ans.115 Dans un autre projet de loi, il a proposé qu’une agence d’État soit créée pour soutenir les importations de machines industrielles en offrant des garanties financières.116
Dans le même temps, Edmond Paul s’est montré soucieux de protéger la souveraineté d’Haïti en tant que nation fondée sur le principe de l’égalité raciale, qui n’était pas respecté dans d’autres pays à l’époque. C’est pourquoi, tout en étant ouvert à l’investissement étranger et à l’immigration pour développer des activités productives, Paul soutenait fermement l’interdiction constitutionnelle de la propriété foncière étrangère. Il considérait les accaparements potentiels de terres comme un risque majeur, car ils transformeraient des agriculteurs autosuffisants en un prolétariat sans terre et mettraient le pouvoir entre les mains d’étrangers racistes à la recherche de rentes, dont les intérêts seraient opposés à ceux du peuple haïtien.117
Dans cette perspective, on peut comprendre qu’Edmond Paul, qui avait lui-même proposé une banque nationale,118 se soit opposé à la banque nationale créée par Salomon en 1880 avec des capitaux français, car elle mettait les finances de l’État à la merci d’intérêts étrangers.119 Il était également opposé à d’autres cas où le gouvernement haïtien empruntait à des pays étrangers à des taux défavorables.120 Comme l’a noté David Nicholls, ces emprunts étrangers ont en effet conduit à une perte considérable de souveraineté, la plus dramatique étant l’occupation américaine de 1915 à 1934.121
Les débats sur la politique monétaire occupent également une grande partie de l’énergie d’Edmond Paul. Lorsqu’il devient député, le gouvernement imprime du papier-monnaie sans garantie pour financer la guerre. Lui et ses collègues du Parti libéral y voient une cause d’inflation et d’affaiblissement de la monnaie haïtienne,122 en plus de se prêter à la spéculation financière qui crée l’instabilité et nuit aux paysans producteurs de café.123 Ils se sont donc battus avec succès pour éliminer le papier-monnaie et le remplacer par des monnaies en métaux précieux,124 considérées comme ayant une valeur réelle.125 Plus tard, lorsque Edmond Paul revint au gouvernement en tant que sénateur sous la présidence d’Hyppolite, après que Salomon eut réintroduit le papier-monnaie, il promut à nouveau la restauration de la monnaie métallique.126
En fin de compte, Edmond Paul avait une vision holistique de ce dont le pays avait besoin pour améliorer sa situation. Si l’industrialisation est l’élément central, il en voit les liens avec d’autres facteurs et s’en préoccupe également. Par exemple, son « Plan de gouvernement » contient de nombreux détails sur la manière de réaliser simultanément la croissance économique, la décentralisation, la stabilité politique et la justice sociale. Edmond Paul fut un homme politique d’une stature exemplaire : loin d’être absorbé par ses intérêts personnels immédiats, il a eu l’ambition de proposer un programme cohérent de développement à long terme.127 Cette hauteur de vue, indépendamment du contenu de ses propositions, est peut-être son plus grand héritage.
L’héritage d’Edmond Paul ne se limite toutefois pas à son impact en tant qu’homme politique. Il mérite également d’être pris au sérieux en tant qu’intellectuel qui a écrit de manière prolifique. Frédéric G. Chéry a relevé certaines des contributions majeures d’Edmond Paul à l’économie en tant que discipline académique en Haïti : sa vision globale d’une économie interconnectée, son souci de l’impact de la politique sur les conditions de vie des gens, son utilisation des statistiques, sa compréhension des dangers d’une économie de rente basée sur une seule denrée… et tout cela n’est tiré que d’un seul des livres de Paul !128